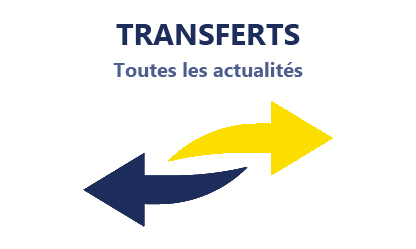Interview, Gilbert Duclos-Lassalle : «C’est difficile à expliquer ce que j’ai pu ressentir »
 Interviews
Interviews
 Interviews
Interviews
Les fiançailles de Gilbert Duclos Lassalle avec Paris-Roubaix ont semblé interminables : 14 ans avant que les deux ne se disent oui il y a 30 ans. Qu’ils semblaient alors loin ses débuts en 1978, lorsqu’il tomba sous le charme de cette course malgré l’avertissement de Jean Pierre Danguillaume, son aîné et coéquipier chez Peugeot : « Si tu n’es pas à l’heure, la porte du vélodrome sera fermée ». « Gibus », fait aujourd’hui partie de la légende de Paris-Roubaix et revient avec nous sur son histoire d’amour avec les pavés.
Au moment de passer professionnel, rien ne vous prédisposait à devenir un spécialiste de Paris Roubaix ?
Non, vraiment rien. Chez les amateurs je courrais beaucoup dans ma région et il n’y a pas de pavés. C’est quand je l’ai fait pour la première fois en 1978 que j’ai eu le déclic, puis bien sûr avec ma deuxième place en 1980.
En 1980 justement, quand vous vous retrouvez devant avec des coureurs comme Roger de Vlaeminck ou Francesco Moser, que se passe-t-il dans votre tête ?
Quand nous sommes sortis de la tranchée d’Arenberg, avec Moser, De Vlaeminck et Thurau, nous revenons sur l’échappée matinale et nous nous retrouvons les quatre. J’ai crevé dans le final, mais aujourd’hui avec le recul j’ai fait aussi des erreurs de jeunesse, peut-être qu’on aurait pu arriver à deux au sprint.
Ce jour là vous comprenez que la victoire est à portée de main ?
A partir de là oui, je me dis que je peux gagner. Il aura fallu pourtant du temps. Et que tout aille pour le mieux. En 1992 tout m’a sourit, je ne chute pas, je ne crève pas, tout se déroule comme on l’avait prévu. Paris-Roubaix ça peut être une journée comme celle-là ou bien ça peut être le pire qui vous tombe dessus.
En 1983 vous terminez à nouveau deuxième. De quoi regretter d’avoir tergiversé avec Francesco Moser et laissé filer Hennie Kuiper vers la victoire ?
C’est vrai quand je me retrouve en tête avec Moser, on roule ensemble et puis à un moment donné on commence à se regarder en chien de faïence. Je ne voulais pas en faire trop, lui non plus. Il voulait gagner son quatrième Paris-Roubaix et je pense qu’il se disait qu’en ayant déjà fait deuxième j’étais quand même plutôt dangereux. On s’est neutralisé un peu et dès que Hennie Kuiper reviens sur nous, il attaque et aucun des deux n’avons voulu faire l’effort pour aller le chercher.
Vous avez côtoyé Roger de Vlaeminck et Francesco Moser. Lequel des deux vous a le plus impressionné ?
Disons que c’est deux styles différents. Moser c’était la puissance et De Vlaeminck était un chat, un vrai félin sur les pavés. La preuve il faisait Paris-Roubaix avec des roues normales et des boyaux normaux. Il était vraiment à l’aise et son agilité venait aussi certainement du cyclo-cross. Il était le plus beau peut-être sur les pavés mais j’aimais bien la façon dont Moser gagnait, et en 1992 je pars un peu dans le même secteur où il avait attaqué.
Dans les années 80 vous continuez à faire des places, mais la victoire ne vient pas. Vous avez toujours gardé foi en cette course ?
Quand je faisais une place il y avait toujours un peu de déception forcément. Je me disais il va falloir encore attendre un an et je me demandais si j’y arriverais. Mais dès la course passée, j’avais ça en tête. Tous les ans je me remettais en question. Je me disais, il faut que je fasse tant de kilomètres dans ma préparation, telle et telle course pour être au rendez-vous. Je faisais plusieurs reconnaissances aussi. D’ailleurs pour moi elles se font bien avant les secteurs, ce n’est pas du marketing qu’on fait sur les pavés pour les photos. Elles doivent se faire 3, 4, voire 5 kilomètre avant le secteur, pour repérer une maison, un château d’eau, une église, quelque chose qui permet de se replacer et d’être dans les 10 premiers à ce moment là si le secteur est dangereux. A Arenberg on sait qu’il y a l’église et qu’après il y a 500 mètres avant de rentrer dedans.
En 1992 vous revoyez votre préparation, en revenant à une course à étapes dans les jours précédant avec le Tour du Pays-Basque.
Je suis revenu à l’ancienne préparation. Pendant une période on faisait la Route du Sud qui était juste avant Paris-Roubaix à l’époque. C’était une course que j’aimais bien et qui me réussissais puisque je l’ai gagné sous ses différentes appellations. Après nous sommes passés à quelque chose de plus classique, en restant en Belgique, avec La Panne ou Gand-Wevelgem. En allant faire le Tour du Pays Basque je me suis aussi éloigné des sollicitations médiatiques, qui étaient nombreuses dans le Nord.
Cette année-là vous sortez à 46 kilomètres de l’arrivée et creusez un écart important. Dans le final Olaf Ludwig revient sur vos talons, mais trop tard. Rien ne semble devoir vous arrêter ?
Quand je sors d’Arenberg cette année-là je me sens très costaud. Je roule au milieu du pavé, je vais vite et arrivent à me suivre Van Poppel, Van Slycke et Wegmuller puis nous revenons sur l’échappée. Wegmuller a été très fort pendant un moment mais il a été éliminé sur crevaison et n’a pu réintégrer le groupe de tête. Au fil des kilomètres je sentais que Van Slycke et Van Poppel étaient moins bien. A une quarantaine de kilomètres je me dis que c’est le moment de les tester, et à Cysoing, sur un secteur dur, je sens qu’ils craquent petit à petit et je pars. A ce moment là l’obsession c’est de creuser l’écart et quand j’ai eu deux minutes, j’ai commencé à en garder un petit peu pour le final.
Après derrière, il faut dire que j’avais une équipe extraordinaire qui neutralisait la course. La seule erreur c’est de laisser partir Ludwig, qui revient très près. Mon directeur sportif vient me voir, j’ai pu accélérer à nouveau et ça lui a mis un coup au moral. Quand on revoit les images à l’approche du vélodrome, on voit son directeur sportif qui tape sur la porte en lui faisant comprendre qu’il ne faut pas lâcher le morceau mais je pense que Ludwig savait qu’il n’allait pas rentrer.
Cette entrée sur le vélodrome reste à jamais gravée dans votre mémoire ?
Daniel Mangeas avait chauffé le public au micro et tout le monde suivait l’échappée sur le grand écran. Quand je suis rentré, j’avais l’impression d’être dans un stade digne d’un match de coupe d’Europe de foot ou du tournoi des six nations pour moi tout seul. C’est difficile à expliquer ce que j’ai pu ressentir. J’ai fais mon tour et demi mais j’aurais pu en faire 20.
Vous étiez alors le plus heureux des hommes ?
J’avais concrétisé mon rêve de gagner Paris-Roubaix, c’était fabuleux. Je gagnais à la façon dont on me connaissait, avec le panache, en partant de loin comme les grands.
Vous l’avez dit, l’équipe Z a réalisé un gros travail ce jour-là derrière vous. L’attitude de Greg Lemond, qui vous renvoie l’ascenseur après ce que vous aviez fait pour lui sur le Tour, a du vous faire chaud au cœur ?
Greg le dit lui-même, « Gilbert m’a fait gagner le Tour 90 ». Quand je fais demi-tour pour l’attendre, alors qu’il avait crevé dans la montée de Marie-Blanque, il faut le calmer, le ramener sur de bons rails et c’est ce que j’ai fait. Deux ans plus tard il me rend ça à Paris-Roubaix. Quand ils arrivent sur le vélodrome on se saute dans les bras, les uns les autres, avec Colotti, Casado, Gouvenou ou Greg.
L’année d’après le scénario de course est différent.
En 1993 je tombe à Arenberg, je crève plusieurs fois mais à chaque fois j’ai des équipiers qui me ramènent ou me donnent leur roue. Quand je reviens à une quarantaine de kilomètres de l’arrivée, je me retrouve avec un groupe de cinq et là il faut réfléchir très vite. Ballerini a attaqué et je savais qu’il fallait le suivre.
La dramaturgie du final est exceptionnelle, avec votre sprint à deux en compagnie de Franco Ballerini. Était-ce aussi fort émotionnellement que l’année précédente ?
C’est différent. Jusque là la presse parlait beaucoup de mon panache mais jamais de mon sens tactique, comme capitaine de route notamment. On en parlait pour Marc Madiot ou d’autres, mais pas pour moi et c’est vrai que ça me faisait râler par moment. En 1993, c’est vraiment le sens tactique qui me fait gagner car avec Ballerini nous étions les deux plus fort je pense, et nous n’avons pas réussi à nous lâcher. Il fallait donc miser sur la stratégie, arriver à faire douter l’autre et j’ai mieux réussi à ce jeu là. Arrivé sur le vélodrome j’étais beaucoup plus à l’aise que lui et quand je revois les images, Patrick Chêne et Robert Chapatte expliquent très bien mon sprint et voient juste sur la ligne, alors que moi je ne sais si j’ai gagné. Quand je m’arrête auprès de mon kiné je luis dis que si je gagne c’est de peu et que si je perds, c’est de peu aussi. A ce moment là, le ralenti passe sur l’écran géant et on m’annonce vainqueur. Tous les journalistes qui étaient parti avec Ballerini l’ont laissé comme une vieille chaussette et sont venus vers moi.
On imagine le désarroi de Franco Ballerini à ce moment-là.
Bien sûr ça été dur pour lui, mais on en a reparlé ensuite, et paix à son âme puisqu’il a disparu tragiquement ensuite, il a dit que je lui avais fait comprendre comment gagner Paris-Roubaix. Son équipe était la grosse écurie sur les classiques et il a reconnu que tout seul j’avais réussi à déjouer leurs plans et à les battre.
L’édition 1994 a aussi beaucoup marqué les esprits, avec des conditions météo très difficiles. La pluie, le froid, la boue et le sort qui s’acharne à nouveau sur vous…
Cette année là France Télévision avait voulu faire un focus sur moi pendant toute la journée et une caméra me suivait de près. Malheureusement avec son motard elle me gêne lors d’une crevaison et quand je reviens devant c’est trop tard, Tchmil est déjà parti.
A l’époque vous avez été novateur avec cette fameuse fourche télescopique, qui sera d’ailleurs abandonnée par la suite.
Je l’ai utilisé pour la première fois en 1991, Greg Lemond aussi l’avait. On a dit ok on avait essayé ça. Nous avions une exclusivité avec Rock Shox, le fabricant. Sur cette fourche il y avait deux molettes, une par fourreau, et c’était un mélange d’air et d’huile. Il y avait cinq graduations dans la suspension et on choisissait à l’entrée d’un secteur. Je n’ai jamais mis les deux dernières graduations, seulement les trois premières. Par exemple à Trois-Villes j’étais sur la première, une tout petite suspension, qui permettait de soulager les poignées et d’éviter de crever. Et c’est vrai que j’avais tendance à moins crever de l’avant. Ensuite quand j’ai gagné elle a été copiée. Les gars venaient me voir, Tchmil par exemple, et je lui avait dit que j’utilisais toute la suspension. Ce qui était faux. Je n’allais pas dévoiler mes secrets. Elle a été abandonné ensuite car il fallait savoir bien adapter ce mélange d’air et d’huile, par rapport à au poids, à la façon de pédaler et le technicien de Rock Shox était le seul à bien maîtriser cela.
Cette année l’équipe DSM va expérimenter une commande de gestion de la pression des pneus placée sur le guidon. Qu’en pensez-vous ?
Pour la pression des pneus à la base, tout dépend de la météo. Avec un temps sec comme cette année et un vent favorable, ça va rouler très vite, donc il faudra un gonflage un peu plus élevé. Après je l’ai vu avec la fourche, pourtant c’était juste une molette avec un quart de tour pour régler la suspension, il fallait vite réfléchir pour savoir comment était le secteur et agir en amont. Là il faudra régler la pression avant de rentrer sur le secteur pavé, car après c’est trop tard, on a plus le temps de lâcher le guidon et donc ça veut dire qu’il faut bien avoir en mémoire la cinquantaine de kilomètres de pavés. D’où l’importance des reconnaissances. Ce n’est peut-être pas forcément évident à utiliser comme technologie finalement. Il doit bien y avoir un témoin pour afficher la pression, mais ce ne sera peut-être pas toujours facile à gérer dans des moments clés, où l’on doit rester concentré sur la course.
Vous êtes toujours impliqué dans le cyclisme et présidez le club de Lescar VS, près de Pau. Vous venez hélas de connaître un épisode tragique il y a quelques jours, avec la chute mortelle en course d’un de vos coureurs, Baptiste Sabatut, à l’âge de 20 ans.
En tant que bénévole et dirigeant, c’est une chose qu’on aimerait jamais voir. Je suis moi-même organisateur de course, avec le tour du Piémont Pyrénéen, et ça fait mal au ventre. L’organisateur était complètement démoralisé car c’est très dur de voir partir un jeune de 20 ans en pratiquant le sport qu’il aime. Le risque existe dans le cyclisme et malheureusement cet accident vient nous le rappeler.
Propos recueillis par Ximun Larre.